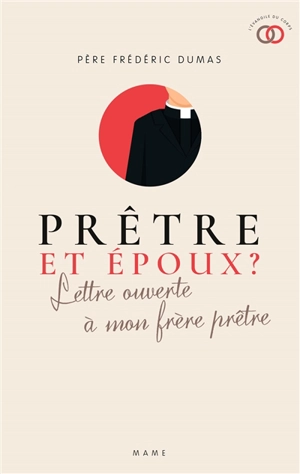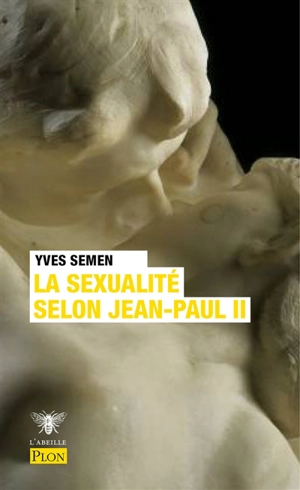L’Institut de théologie du corps par Yves Semen

Bonjour, M. Yves Semen, vous êtes le président et le fondateur de l’Institut de théologie du corps, qui tire son nom et son inspiration de la théologie du corps de saint Jean-Paul II.
Pouvez-vous nous dire brièvement ce que cet enseignement de saint Jean-Paul II sur la théologie du corps a de nouveau dans l’histoire de l’Église ?
Alors, je vais faire court… Parce qu’il y a beaucoup de nouveautés dans la théologie du corps,
mais il y en a deux qui me semblent essentielles.
La première, c’est que Jean-Paul II a l’audace, en quelque sorte, de considérer et de montrer que le corps humain, tel qu’il a été voulu par Dieu, a pour vocation d’exprimer quelque chose du mystère trinitaire de Dieu.
Par quoi l’exprime-t-il ? Par la dimension du don que le Créateur a inscrit dans le corps de l’homme et dans le corps de la femme. Le corps de l’homme est pour le corps de la femme. Le corps de la femme est pour le corps de l’homme. Et, de ce don mutuel, peut jaillir une communion des personnes qui rend l’homme et la femme image de la communion trinitaire des personnes divines. Parce que Dieu est avant tout un mystère de communion de personnes qui résulte de l’absolu du don mutuel des personnes dans la Trinité.

Eh bien, Dieu a voulu mettre l’image de ce qu’il était comme cœur brûlant d’amour, cœur brûlant de communion. Il a voulu en mettre l’image, il a voulu en mettre la manifestation, dans le corps humain de l’homme et de la femme, qui apprennent, de leur corps, qu’ils sont faits pour le don d’eux-mêmes. Et réaliser ainsi, dans le monde, l’image du mystère, comme dit Jean-Paul II, du mystère invisible caché en Dieu de toute éternité, c’est le mystère de la communion des personnes divines, l’image dans le monde de cette communion trinitaire.
Alors ça c’est une première nouveauté parce que, jusqu’à présent, on avait surtout vu l’image de Dieu en l’homme sous l’angle où l’homme était doué de facultés spirituelles, une intelligence ouverte au vrai, la volonté ouverte au bien, une âme spirituelle, bref, un angle qui le rendait quelque peu semblable à Dieu qui est pur esprit, autrement dit on avait une vision un peu spiritualiste de l’image de Dieu.
Jean-Paul II nous montre une image incarnée, une dimension incarnée de l’image de Dieu : ça, c’est effectivement une nouveauté, qui n’est pas, d’ailleurs, sans susciter quelques oppositions de certains dans l’Église, mais ça ce n’est pas grave.
La deuxième chose importante, c’est qu’il renouvelle complètement la théologie classique du mariage. On avait jusqu’à lui, d’une certaine manière, considéré le mariage comme le dernier des sacrements. D’ailleurs saint Thomas d’Aquin dit que, si on le met en dernier, c’est parce que c’est celui qui confère le moins de grâces, et par conséquent il est normal de le mettre en dernier. C’était au XIIIe siècle…
Jean-Paul II a une vision beaucoup plus positive du mariage. Il montre qu’en fait Dieu veut se dire dans l’alliance originelle de l’homme et de la femme, je vous l’ai dit tout à l’heure, c’est la première réalité. Mais il se dit en plénitude dans l’union du Christ et de l’Église, le Christ qui est réellement un Époux, l’Église qui n’est réellement qu’une épouse, de telle sorte, dit-il, que le mariage, pour être authentiquement chrétien, doit être articulé aux noces du Christ et de l’Église, ce grand mystère dont parle l’Épître aux Éphésiens au chapitre 5. Le grand mystère de Dieu se réalise en plénitude dans l’union sponsale, ou nuptiale si vous voulez, entre le Christ et l’Église. De telle sorte que le mariage chrétien est destiné à rendre cette réalité visible.

Un mariage authentiquement chrétien doit être articulé à cette réalité du Christ Époux de l’Église, son épouse, ce qui est terriblement exigeant, parce que l’amour que le Christ Époux donne à l’Église, son épouse, va jusqu’au sacrifice de la Croix, et que l’amour que l’Église s’efforce de rendre au Christ, en retour de son amour d’Époux, va jusqu’au martyre. Autrement dit, il y a une dimension sacrificielle dans le mariage, et par ce biais-là, le mariage coopère à l’œuvre de la Rédemption.
Donc, coopérant de manière privilégiée à l’œuvre de la Rédemption, tous les sacrements, qui sont l’effusion de l’œuvre de la Rédemption – on dit que le Christ nous a mérité tous les sacrements sur la Croix, qu’ils sont déversés sur l’Église par son côté ouvert –, tous les sacrements qui sont issus de l’œuvre de la Rédemption doivent être lus et compris dans la lumière que projette la réalité du mariage sur tous les sacrements. Et donc, il va jusqu’à dire : le mariage, aux origines, le mariage de nos premiers parents, l’union que Dieu a voulue pour dire son être trinitaire, ce mariage devient le prototype de tous les sacrements de la Nouvelle Alliance.
Donc là, il y a une révolution dans la théologie sacramentaire du mariage et, à travers elle, toute la théologie sacramentaire, parce qu’en fait, il faut relire tous les sacrements à travers cette clé de lecture qui est la nuptialité, ou la sponsalité, comme dit Jean-Paul II, et voir comment il y a une dimension d’alliance dans le baptême, comment il y a une dimension d’alliance sponsale dans l’Eucharistie, comment il y a une dimension d’alliance dans le sacrement de l’ordre, dans la confirmation, etc.

Et donc là, il y a un gros travail à faire pour les théologiens. Certains ont commencé à le faire, je pense notamment au cardinal Ouellet, je pense au cardinal Scola, qui ont exploité ces jalons que pose Jean-Paul II sur la théologie du corps en matière sacramentaire.
Voilà, ce sont les deux grandes nouveautés, et qui sont prometteuses.
Vous écrivez que saint Jean-Paul II tenait particulièrement à ce que la théologie du corps soit enseignée en France. Pourquoi pensait-il que la France en avait particulièrement besoin ?
Ce n’est pas qu’il pensait que la France en avait besoin, il pensait que le monde en avait besoin et que ça passait par la France.
Vous savez, il connaissait très bien la France. Il y avait séjourné pendant ses études au séminaire, et puis il aimait la France. C’est l’un des pays qu’il a le plus visités, au cours de ses voyages apostoliques. Et je crois qu’il était particulièrement conscient – alors pardonnez-moi, ça va faire un peu chauvin ce que je vais vous dire, il n’y a aucun chauvinisme là-dedans, il y a plutôt l’appel à une exigence de service – il était conscient que la France avait une certaine vocation à l’universalité.
Et c’est vrai que si vous regardez bien, le nombre de choses, le nombre d’idées nouvelles, en bien et en mal d’ailleurs, qui sont issues de la France, c’est colossal. Je ne prends qu’un exemple, la clé de lecture gauche-droite pour lire la réalité politique, c’est nous qui l’avons avancée. À la révolution française, au moment de la Constituante, certains se sont mis à gauche des autres, pour manifester leur opposition, si bien que les autres sont retrouvés à droite. Et donc cette répartition de gauche-droite, la philosophie des Lumières, l’idée de la laïcité, on les a exportés, nous avons un génie extraordinaire pour exporter le meilleur. Le meilleur : pensez que par exemple au XIXe siècle, pratiquement les deux tiers des missionnaires étaient français, dans le monde. Et puis quelquefois le pire…
Et cela fait référence à quelque chose que mentionnait déjà le cardinal Pacelli, futur Pie XII, dans un discours qu’il a donné, une homélie qu’il a donnée à Notre-Dame de Paris en 1937 – c’était juste avant d’être élu pape – sur la vocation de la France. C’était extraordinaire, il faut relire ce texte.
Il y a une vocation de la France, il y a une vocation évangélisatrice, il y a une vocation missionnaire. La France est fille aînée de l’Église, c’est la première nation à avoir été baptisée, en 496, à travers le baptême de Clovis et de ses principaux barons. Donc, il y a vraiment une vocation. Autrement dit, c’est que le monde en a besoin, et Jean-Paul II pensait que c’est par la France que ça devait passer.
Et je voudrais donner un deuxième témoignage qui avait été donné là-dessus. Il est d’un professeur éminent, qui enseigne aux États-Unis, docteur en philosophie, docteur en théologie, un laïc, il est père de huit enfants. Il s’appelle Michael Waldstein, il est autrichien d’origine, il enseigne aux États-Unis. Et c’est lui qui a publié la première édition critique intégrale des catéchèses sur la théologie du corps en 2006, donc l’édition anglo-américaine. Je l’ai rencontré lors d’un colloque sur la théologie du corps à Rome, en 2010 ou 2011. Et nous avons dîné ensemble, j’intervenais aussi, on faisait partie du dîner des intervenants. Nous avons échangé ensemble. Et il m’a dit la chose suivante, un Autrichien qui enseigne aux États-Unis, il m’a dit : « Publiez, publiez une édition critique intégrale française », comme il l’avait fait pour l’anglais. Et il me donne la raison suivante : « Tant que la France ne se sera pas emparée de cet enseignement, le monde persistera à l’ignorer ». Étonnant. Un Autrichien enseignant aux États-Unis, donc il ne peut pas être accusé de chauvinisme franco-français, si vous voulez !
Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans, mais c’est aussi cette interpellation de Jean-Paul II : « France, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? » Il y a des promesses qui sont données dans le baptême. Il y a des promesses d’engagement, il y a des promesses de service, il y a des promesses missionnaires, il y a des promesses d’évangélisation. Est-ce que la France y est fidèle ? C’est toute la question.
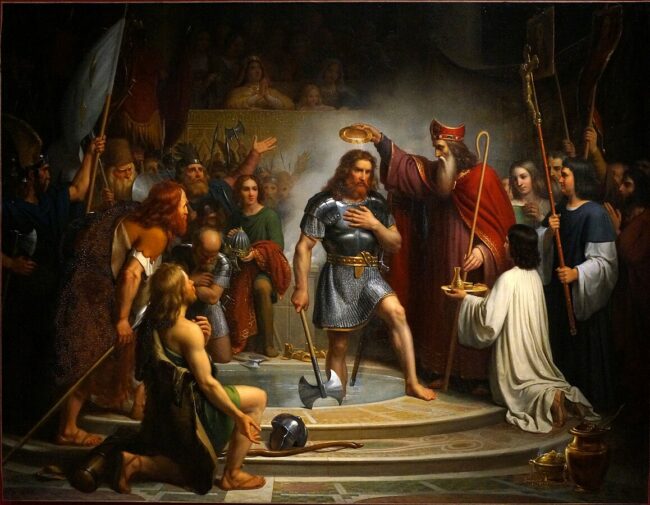
La mission de l’Institut de théologie du corps est-elle uniquement d’enseigner et de diffuser les catéchèses de saint Jean-Paul II sur la théologie du corps ?
S’il fait ça, ce sera déjà pas mal. Et c’est pour cela qu’on se concentre là-dessus. Autrement dit, notre vocation, ce n’est pas de développer des offres d’éducation. Non, nous sommes un institut universitaire, nous sommes un établissement privé d’enseignement supérieur. Nous sommes déclarés comme tels au rectorat de l’Académie de Lyon.
Notre mission essentielle, centrale, fondamentale, c’est que cet enseignement soit diffusé, qu’un certain nombre de gens qui auront des responsabilités dans l’Église, et même en dehors de l’Église, se l’approprient, et puissent en faire rayonner l’essentiel. Parce que c’est une nécessité absolument urgente dans notre temps.
Vous voyez, cette théologie du corps de Jean-Paul II, c’est le grand cadeau de son pontificat.
C’est pour cela qu’il a voulu le donner en premier. Il l’a donné au tout début de son pontificat, durant les cinq premières années de son pontificat, entre 1979 et 1984. C’est le grand leg, en tout cas, c’est ma conviction. C’est le grand leg qu’il a laissé à l’Église et qu’il a voulu donner en tout premier, comme si il anticipait peut-être les obstacles qui pourraient s’élever sur sa route s’il tardait trop.
Pensez quand même que, le 13 mai 1981, jour de l’attentat de la place Saint Pierre, il n’y avait pas de catéchèse sur la théologie du corps ce jour-là parce qu’il devait consacrer l’audience générale à deux annonces : la première, c’était la création du Conseil pontifical pour la famille, qui n’existait pas. Il n’y avait rien, parmi les dicastères du Vatican, consacré à la famille. C’est quand même incroyable ! Donc il a créé un conseil pontifical pour la famille. Il devait en annoncer la création ce jour-là. Et puis la deuxième chose, c’est la création d’un institut pontifical pour les études sur le mariage et la famille, auquel il avait donné l’occasion de s’approprier cet enseignement sur la théologie du corps, qui représente quand même 800 pages de texte. C’est 1,350 kg de papier. Donc cet institut aurait la capacité de former des personnes qui seraient capables de la diffuser. Eh bien ce sont ces deux annonces qui ont été empêchées par l’attentat perpétré contre lui par Ali Ağca. C’est quand même assez étonnant.

L’institut touche-t-il uniquement les catholiques pratiquants ?
Surtout, mais pas que. En tout cas, quand ils ne sont pas assez pratiquants, généralement ils le deviennent.
Et vous voyez, cette année, nous avons même un pasteur protestant. Je vous avoue que je l’ai prévenu : « Attention, nous sommes des affreux papistes ! Nous enseignons la pensée d’un souverain pontife, et dans la continuité de l’enseignement de tous les souverains pontifes. Et on fait de la théologie catholique. » « Mais justement, c’est ça qui m’intéresse. » Donc, nous avons un pasteur protestant, qui est tout à fait ravi de l’enseignement qu’il reçoit ici. Il m’est arrivé d’intervenir plusieurs fois pour des auditoires de protestants. Moi, ça me va bien. C’est assez bien reçu, cette théologie du corps. Au moins dans sa première partie. Par le monde anglican, par exemple. La deuxième partie sur le mariage, un peu moins. Mais la première partie, la partie anthropologique, oui.
Généralement, quand même, pour s’engager sur deux ans d’études de théologie catholique, il faut être un petit peu accroché au plan de la foi. Mais si on ne l’est pas assez, on le devient.
Pouvez-vous nous présenter le mastère en théologie du corps ?
Alors, ce mastère, il a pour originalité d’enseigner la théologie du corps de manière systématique. C’est-à-dire que nous avons pris les 135 catéchèses – parce qu’il y a 135 catéchèses, qui correspondent à un plan assez structuré de la part de Jean-Paul II. Et nous l’avons découpé en 24 cours fondamentaux. Chaque cours fondamental dure 11 heures. Vous voyez, c’est quand même assez consistant ! Et donc, on balaye toutes les catéchèses systématiquement, en travaillant le texte même de Jean-Paul II. Parce que c’est un texte qui est extrêmement fouillé. Il ne laisse rien au hasard. C’est extrêmement rédigé.
Et donc, nous en faisons une étude un petit peu à la manière du commentaire médiéval : si on prend le texte, il dit ça. Pourquoi est-ce qu’il dit ça ? D’où ça vient ? Quelles sont les conséquences ? Un peu à la manière dont saint Thomas d’Aquin commentait les œuvres d’Aristote. On fait du commentaire dans le style médiéval du terme. Même si on n’est pas du tout moyenâgeux !
Et puis, de façon à ne pas rester dans les hautes sphères éthérées, entre deux cours fondamentaux, nous avons un séminaire de la même durée. Onze heures. Vingt-quatre séminaires de onze heures. Qui vont soit approfondir un point, soit élargir le point de vue, soit confronter ce point avec des perspectives contemporaines.
Par exemple : finalement, la théologie du corps, c’est une théologie de la masculinité et de la féminité. Avant tout. Comment est-ce que cela rencontre les discours sur le gender actuellement ? Donc nous avons un séminaire sur le gender.
Cette théologie du corps fait du corps une composante anthropologique absolument fondamentale. C’est-à-dire qu’en fait, nous sommes notre corps. Et notre corps exprime notre personne. Comment est-ce que cela rencontre les prétentions du transhumanisme, qui voudrait transformer le corps en une certaine mécanique, en espérant, d’ailleurs, une certaine conquête de l’immortalité ? Donc nous avons un séminaire sur le transhumanisme, ainsi que sur les questions éthiques contemporaines, les questions bioéthiques, les questions liées à la contraception, les questions liées à la procréation médicalement assistée, à la gestation pour autrui, etc. Et puis, les questions épistémologiques : quels sont les rapports entre foi et raison ? Entre foi et science ? Etc.
Ou alors, on approfondit une perspective, par exemple : toute la doctrine de l’amour chez Wojtyła.
Déjà dans son premier ouvrage, Amour et responsabilité, en fait, elle est inspirée de saint Jean de la Croix. Sur qui, d’ailleurs, Wojtyła avait fait sa thèse de doctorat de théologie. Il avait fait sa thèse sur la foi chez saint Jean de la Croix. Donc si on ne comprend pas la doctrine de l’amour chez saint Jean de la Croix, il n’y a aucune chance que l’on comprenne la doctrine de l’amour chez Jean-Paul II. Eh bien, on a un séminaire de onze heures sur saint Jean de la Croix, etc.

Donc, une sorte de pédagogie à deux temps : dans un premier temps on plonge dans le texte de Jean-Paul II, et on essaie de le comprendre jusqu’au bout. Et puis, on sort la tête de l’eau en quelque sorte, et on essaie de regarder autour, et on voit comment cela renvoie à des problématiques contemporaines ou à des nécessités d’approfondissements théologiques sur tel ou tel point.
Voilà la pédagogie, à deux temps, de ce mastère, qui est assez fécond et qui est plébiscité par nos étudiants.
Ce mastère est-il suivi uniquement par des prêtres et des consacrés ?
Pas mal de prêtres et consacrés, ça fait à peu près 25% de nos effectifs. Donc nous formons des prêtres qui, la plupart du temps, nous sont envoyés par leur évêque, pour prendre des responsabilités pastorales dans leur diocèse d’incardination : pastorale de la famille, pastorale des couples, pastorale des jeunes, pastorale de la catéchèse. Donc il y a à peu près 25% de prêtres et de religieux, religieuses.
Tout le reste, ce sont les laïcs. Quelque fois, nous avons même des étudiants qui sont mariés, et qui suivent en couple. Je vous rassure, ils passent les examens séparément ! Mais ils suivent en couple. On a eu une bonne dizaine de couples qui ont suivi notre mastère ensemble et qui ont vu leur mariage complètement transfiguré.
À quoi prépare ce mastère ?
Je crois qu’il prépare d’abord à une vie chrétienne plus authentiquement enracinée. Et dans le cœur même du mystère du désir de Dieu pour l’homme.
Mais ça prépare bien sûr aux responsabilités dans tous les domaines de la pastorale : on a besoin d’une juste vision du corps et la vision la plus aboutie que donne l’Église sur le corps humain. Parce que l’Église a quelques longueurs d’avance en matière anthropologique là-dessus. En tout cas, Jean-Paul II a donné quelques longueurs d’avance à l’Église.
Vous savez, George Weigel, le biographe américain de Jean-Paul II, qui a publié sa biographie en 1999 – donc Jean-Paul II était encore de ce monde –, il dit que cette théologie du corps, lorsqu’elle sera vraiment prise en compte, constituera un tournant non seulement pour la théologie catholique, mais pour toute l’histoire de la pensée contemporaine. Donc, elle est très lourde de conséquences.
L’Église est à la pointe donc il faut pouvoir transmettre cela, dans tous les secteurs où la question du corps est engagée, dans la pastorale des jeunes, bien sûr, dans la catéchèse, dans la préparation des sacrements, etc. En voyant cette dimension de nuptialité qui éclaire la réalité de chacun des sacrements. Dans toutes les questions liées à la pastorale des couples et de la famille, évidemment, notamment tout ce qui tourne autour du service de la vie.
Donc la pastorale de la famille, la pastorale du mariage, et puis aussi la pastorale de la fin de vie, parce qu’il y a toute une réflexion extrêmement intéressante, extrêmement approfondie, de Jean-Paul II, sur le corps destiné à la résurrection. Notre corps, il est fait pour la résurrection, il n’est pas fait pour disparaître, devenir poussière, et de telle sorte que pour l’éternité, nous serions des petites âmes chantant perpétuellement des hosannas et des alléluias dans le Paradis. Non, nous sommes destinés à la résurrection finale de notre chair, ce qui va être un événement absolument monumental, il va être contemporain de la Parousie, du retour du Christ dans la gloire à la fin des temps, résurrection de la chair, jugement général, ça va être une sacrée affaire, cette affaire-là !
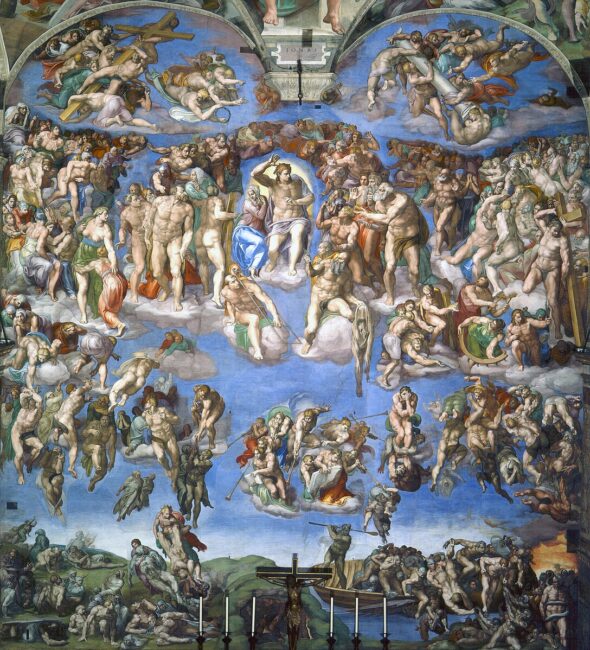
Donc nous sommes destinés à la résurrection, et ça il faut en prendre conscience, les chrétiens n’en sont pas assez conscients : quand on croit à la Résurrection du Christ, c’est déjà pas mal, parce qu’il paraît que 50% n’y croient pas. Mais leur propre résurrection… Vous voyez, nous ne sommes pas assez convaincus que nous sommes faits pour la résurrection, et que notre bonheur éternel inclura la participation de notre corps à ce bonheur éternel. Et ça c’est capital. Donc il y a toute la pastorale de la famille, toute la pastorale des funérailles, etc., il faut que ce soit proclamé à ces moments-là.
Il y a des champs énormes à développer, et je dirais même que ça va assez loin, parce que cette théologie du corps fonde, comme jamais cela n’a été fait, la dignité de la personne humaine. Or la dignité de la personne humaine, c’est un principe clé de la doctrine sociale de l’Église. Donc il faut savoir pourquoi la personne humaine est digne. Et sa dignité, elle procède fondamentalement que la personne, la personne humaine, c’est le grand projet d’amour de Dieu. Alors quand on le voit dans la lumière de la théologie du corps, on comprend mieux la dignité inaliénable de toute personne, et par conséquent, on comprend mieux toutes ses conséquences dans l’ordre économique et social. Autrement dit, ça irrigue toute la doctrine sociale de l’Église.
Ces deux années de formation intense, pour les étudiants du mastère, ces deux années doivent être une expérience bouleversante : être ainsi plongés dans les enseignements sur des sujets trop peu abordés dans l’Église, et tellement en opposition avec la pensée dominante.
Oui, mais je crois que ce qui les bouleverse le plus, et je les en préviens au début, c’est la façon dont cela impacte, comme on dit aujourd’hui, où cela influe sur leur propre perception d’eux-mêmes. Et c’est la juste place de notre corps dans la perception de ce que nous sommes, le prix immense qu’a notre corps, l’acceptation bien sûr de ce corps, et je dirais même le juste amour de notre corps. Vous savez ce que Jean-Paul II avait dit aux jeunes à propos du corps : « Mépris du corps, jamais, idolâtrie du corps, pas davantage, maîtrise et estime du corps, oui. »
Donc ça remet en cause pas mal de choses. Quelques fois, c’est rare, mais c’est arrivé, c’était tellement bouleversant et perturbant, surtout par rapport à des histoires qui se sont quelquefois passées, de blessures profondes, que certains n’ont pas pu continuer. Il y en a eu peu mais c’est arrivé.
En tout cas, ceux qui sont allés jusqu’au bout n’en sont pas sortis indemnes, en quelque sorte. Je les en préviens : « Faites attention, vous n’êtes pas là simplement pour faire un exercice cérébral, ça va bouleverser un petit peu votre vie. »
Je pense à des prêtres aussi, qui ont été complètement renouvelés dans leur sacerdoce par cet enseignement, parce qu’attention, ça n’est pas fait que pour les gens mariés cette théologie du corps ! Il y a une dimension nuptiale dans le sacerdoce. Le prêtre doit avoir un cœur d’époux, configuré au cœur époux du Christ qui est l’unique prêtre. Donc quand on dit que le prêtre devient un autre Christ, alter christus, normalement, comme dit le cardinal Sarah, ipse christus, le Christ lui-même, eh bien il prend conscience qu’il ne peut pas vivre pleinement son sacerdoce sans le vivre comme une œuvre de nuptialité. Le prêtre, en quelque sorte, se donne comme un époux à l’Église, c’est l’Église son épouse. C’est pour ça qu’il ne faut pas les marier, ils sont déjà mariés, ça en ferait des bigames !
Et donc ils découvrent ça. Il y a un prêtre qui a été tellement bouleversé par ça qu’il a publié deux livres : Prêtre et époux et puis Le sacerdoce à l’épreuve, deux magnifiques ouvrages. Maintenant il prêche retraite sur retraite pour les prêtres, pour leur faire découvrir cette dimension sponsale de leur sacerdoce, dont on trouve les fondements dans la théologie du corps, et dont on trouve des développements par exemple dans l’exhortation Pastores dabo vobis : Je vous donnerai des pasteurs de Jean-Paul II en 1992.
Pouvez-vous nous présenter les parcours Apprendre à aimer ?
Les parcours Apprendre à aimer sont destinés à faire des parents de vrais parents, et qui exercent réellement leurs responsabilités de parents à l’égard de leurs enfants, au plan de l’éducation affective, relationnelle et sexuelle comme on dit aujourd’hui. Parce que, remarquez bien, on constate qu’il y a beaucoup de parents qui, sur ces questions-là, disent : « On inscrit nos enfants dans des écoles catholiques et elles vont se charger du problème. » Ben non, c’est leur responsabilité.
Alors je suis d’accord, ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile à faire, c’est souvent beaucoup plus difficile de parler des réalités de la sexualité et de l’amour à ses enfants que d’en parler à d’autres personnes. Moi-même j’en fais là personnellement l’expérience, j’en ai fait l’expérience et c’est paradoxal, parce que ce sont les parents qui ont la grâce d’état. La grâce d’état il faut y croire, c’est que nous avons la grâce pour parler de ces réalités-là avec nos enfants, et c’est aux parents qu’il est le plus difficile de le faire. Et donc il faut leur donner des outils. Il faut leur donner d’abord la vision, nous la puisons dans la théologie du corps, pour éveiller les enfants d’abord à la beauté du corps, à la bonté du corps, à la beauté de la sexualité, à la grandeur de cela, montrer que c’est voulu de Dieu.
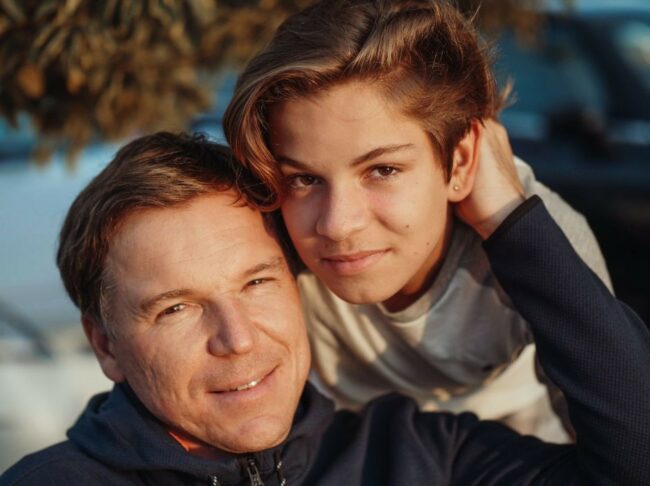
Vous voyez, quelquefois on dit : « Ah, mais c’est Dieu qui l’a voulu ! », dans une espèce d’attitude volontariste, on trouve que c’est un peu sordide, sale, la sexualité, mais c’est Dieu qui l’a voulue. Donc non, il faut rentrer dans l’intelligence amoureuse du plan de Dieu sur la sexualité humaine. La théologie du corps nous donne des clés pour ça. Et puis il y a toutes les attitudes, le vocabulaire, les gestes, le langage, toute la façon de transmettre cela de manière appropriée.
Donc ça donne les deux sessions, qui sont animées par Inès Pelissié du Rausas, qui est vraiment une orfèvre en la matière. C’est une mère de famille, elle a cinq enfants et elle a publié un nombre de livres impressionnant sur le sujet, pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes. Le but c’est de faire en sorte que les parents puissent s’armer pour exercer une dimension absolument fondamentale de la responsabilité éducative de parents, et qu’ils cessent de balancer la patate chaude, si vous permettez l’expression, à des prétendus spécialistes, en disant : « Ils vont faire le boulot à notre place ». Mais il ne le feront pas à leur place. En tout cas, ils ne le feront pas de la manière dont les parents ont la grâce d’état pour le faire.
Ce que vous venez de dire répond un peu à ma question suivante : pensez-vous que ces parcours peuvent donner des armes aux parents qui seront confrontés au nouveau programme d’éducation affective et sexuelle prévu par le gouvernement ?
Oui, encore que le but, ce n’est pas de former des militants qui, du point de vue politique, se battent, même si… Le but, c’est de former des parents qui exercent leur responsabilité de parents. Alors, s’ils le font, ensuite, le programme scolaire, ce n’est pas grave. Ils vont lui raconter ce qu’ils voudront. Un enfant croit plus facilement son père et sa mère sur ces questions-là que d’autres personnes. Encore que quelques fois la maîtresse a plus d’autorité… Et ça dépend quand c’est fait.
Parce qu’il ne s’agit pas d’enseigner. Vous voyez, qu’est-ce qu’ils vont faire dans l’école ? Ils vont enseigner des trucs. Des parents, ce n’est pas enseigner qu’ils font. C’est transmettre de manière vitale quelque chose. Encore faut-il qu’ils en soient intimement persuadés. C’est pour ça qu’il faut passer par la première session d’Apprendre à aimer, où on intègre pour soi l’intelligence du corps, en acceptant de se laisser un peu bousculer par elle, de façon, deuxième session, à être capable d’utiliser le juste langage, pas la boîte aux outils, mais les moyens concrets et pratiques de mettre en œuvre cela.
Et quand les parents font cela, je crois que leurs enfants sont perpétuellement reconnaissants. Même si ce n’est pas facile. Il faut vraiment que les parents se laissent convaincre qu’il n’y a qu’eux qui peuvent remplir ce rôle. Et c’est leur responsabilité. Si l’école intervient, c’est par délégation de l’autorité parentale. Par délégation. Ils sont les mieux placés pour le faire.
Même si, je sais, c’est difficile. Même si je suis le premier à être dans cette situation-là. Je n’ai aucun problème pour parler de sexualité avec n’importe qui. Avec mes propres enfants, c’est plus difficile. Et pourtant ils sont en soif. Je vous donnerai un seul exemple, parce que c’était un bon coup pour mon humilité. Il y a un de mes amis qui avait cinq garçons et qui m’a demandé : « Il faut qu’ils lisent tous La sexualité selon Jean-Paul II », le premier bouquin que j’ai publié. Donc, il m’a apporté cinq exemplaires pour que je les dédicace pour chacun de leurs enfants. Et je me suis dit : « Je n’ai pas pensé à faire ça pour mes propres enfants ! ». Il y en a un qui est rentré de pension. Soit, immédiatement, je prends dans ma bibliothèque un exemplaire, je lui fais un petit mot. Je lui dis : « Mon chéri, je suis désolé, je n’ai pas pensé. Peut-être qu’il y a des choses qui t’intéresseront. On peut en parler, etc. » Et lui, il me répond : « Mon pauvre Papa ! Ça fait déjà six mois que je l’ai acheté en librairie ton bouquin. »
Autrement dit, ils sont en soif. Ils sont en soif. Et il faut que les parents se laissent persuader que même s’ils ne le disent pas, ils attendent une parole que seul leur papa, seule leur maman, peut leur donner.
Quelle est la dimension de recherche à l’Institut de théologie du corps ?
Nous sommes un institut universitaire, donc on fait de la recherche. Sinon, on ne serait pas très crédibles. Et notre recherche est transmise à travers notre revue, la revue que nous publions, la revue Ecce corpus, qui est publiée deux fois par an, donc c’est semestrielle. Nous en sommes au numéro 12. Nous avons des grandes signatures. Bien sûr, nos professeurs du mastère, que nous publions en priorité, mais pas seulement. Nous avons des professeurs dans le réseau international de la théologie du corps, donc en Italie, en Espagne, en Belgique, jusqu’en Pologne, qui nous donnent leurs signatures, qui nous donnent des articles, qui sont évidemment étudiés par un comité scientifique de lecture, et qui sont publiés ensuite dans cette revue.
Alors évidemment, ce sont des articles universitaires, ce n’est pas de la vulgarisation. Pour la vulgarisation, nous avons un autre canal de publication, c’est la collection L’Évangile du corps, dont nous avons la responsabilité aux éditions Mame, et dans laquelle nous avons publié déjà un certain nombre d’ouvrages. Il y a les deux ouvrages du père Frédéric Dumas, dont je vous parlais tout à l’heure, qui ont été publiés là-bas. Nous avons publié un très bel essai-témoignage, avec Godefroy et Sophie de Bentzmann, et le père Paul Habsburg, nous avons publié l’ouvrage d’Inès Pelissié du Rausas, un ouvrage de François de Muizon aussi, voilà, donc j’ai de bonnes demi douzaine de titres dans cette collection. Alors ça, c’est pour le grand public.
Pensez-vous que la théologie du corps a beaucoup influencé l’évolution de l’Église au XXIe siècle ?
Pas encore. Nous sommes au tout début.
George Weigel, là encore, le biographe américain du pape, disait que cette théologie du corps pourrait exploser, une sorte de bombe à retardement théologique, disait-il, avec des effets spectaculaires au cours du XXIe siècle.
Pour le moment, en tout les cas en France, on a l’impression que c’est plutôt un pétard mouillé, plutôt qu’une bombe à retardement, ça met du temps, ça démarre doucement.
Alors, quand même, voyez une initiative comme les forums Wahou !, – ce n’est pas lié à l’Institut de Théologie du Corps. On m’a demandé d’y intervenir. J’y suis allé, bien évidemment. Ça fait quand même près de 15 000 personnes qui ont été sensibilisées à la théologie du corps, rien qu’en France. Donc les choses commencent à bouger un petit peu.
Mais, et je vous avoue que j’ai découvert ça tout récemment, la semaine dernière, il y a une équipe de jeunes, alors, des fous de Dieu, des jeunes baptisés, qui sont baptisés depuis un an, deux ans, six mois, qui ont entre 18 et 25 ans, qui ne sont pas à Notre-Dame-d’Auteuil, qui ne sont pas à Saint-François-Xavier, là, à Paris, ils sont dans le dix-neuvième arrondissement, rue de Tanger, métro Stalingrad. Alors, il s’appelle Curtis, il s’appelle Mehdi, il s’appelle Mustapha, il s’appelle Samy, il s’appelle Nono, ils ont des dreadlocks, ce n’est pas des cathos bon chic bon genre qu’on voit dans certains groupes de prière. Mais ils ont le feu sacré et ils ont créé un portail : leur dernière vidéo sur le carême, trois millions de vues sur TikTok, trois millions trois cent mille même, deux millions quatre cent mille sur Instagram, un demi-million de likes, comment font-ils ? Alors, j’ai passé deux heures, il y avait trois caméras, un vrai studio, c’est relativement simple, mais un vrai studio professionnel, on a passé deux heures, en soirée. J’ai été interviewé par Curtis et Samy. Ils ont lu la théologie du corps, eux. Et ils avaient les éditions intégrales des catéchèses qu’il fallait que je leur dédicace, ils ont lu, et là : « Il faut nous parler de ça, il faut que vous nous disiez l’enseignement de l’Église, nous ce qu’on pense, ça n’a aucune importance, l’important c’est l’enseignement de l’Église. »
Vous voyez, je me demande si ce n’est pas là que ça va exploser la bombe à retardement, et pas là où on pourrait croire. Ça fait réfléchir, et cela permet de penser peut-être autrement la volonté de notre pape François : oui il faut aller aux périphéries, il faut aller aux périphéries de l’Église. Ils sont dans les périphéries, les périphéries sociologiques, mais ils sont au cœur même de l’Église dans son dynamisme missionnaire. Ils se défoncent, ils se défoncent bénévolement. Et puis ils en veulent, et donc ils en donneraient à revoir, peut-être – j’ai rien contre non plus, parce que je pense qu’ils sont appelés aussi à un dynamisme missionnaire – aux cathos, bon chic, bon genre, qui se mouillent peut-être un peu moins pour l’Évangile que ces jeunes-là. Peut-être.
Est-ce que promouvoir la théologie du corps est une façon de promouvoir la défense de la vie ?
Évidemment, parce que Jean-Paul II nous montre très clairement que la signification sponsale du corps, la signification du don du corps, comme je vous expliquais tout à l’heure, est indissociable de sa signification procréatrice. Quand on comprend bien pourquoi notre corps est un corps de don, nous comprenons que notre corps est un corps de don pour donner la vie, évidemment.

Alors, ce n’est pas militant, la théologie du corps, mais ça nous donne la lumière en profondeur pour peu que nous acceptions de la recevoir, de façon à éviter que nous soyons un peu des chrétiens qui fonctionnent à coup de slogans. C’est très bien d’être pour la vie, aucun problème, j’ai huit enfants. C’est très bien, mais le plus important c’est de savoir pourquoi on l’est, vous voyez ?
Voyez le monde est en face de nous, que nous considérons souvent comme agressif par rapport à notre foi. En fait, il ne manque qu’une seule chose, c’est de rendre compte de l’espérance qui est en nous.
Autrement dit, c’est pour cela que les chrétiens doivent se former et je crois que les chrétiens sont des paresseux, sont des paresseux ! Ils ne prennent pas le temps de se former, ils ne prennent pas le temps de lire, ils ne prennent pas le temps de travailler ! Ils sont des champions de la résolution des équations différentielles du deuxième ordre, ils passent les concours des grandes écoles, ils rentrent à Centrale et à Polytechnique, à HEC, mais ils sont infoutus de consacrer le quart du dixième du vingtième de cette énergie à l’appropriation de leur foi ! Vous voyez, je suis violent là-dessus, mais je crois qu’il faut l’être, les chrétiens sont des paresseux. Il nous sera demandé compte de ça.
Et, quelques fois, on a des chrétiens qui raisonnent à coup de slogans. Il faut défendre la vie. Oui, d’accord, dis-moi pourquoi. Rends compte, rends compte. Des injonctions. Autrement dit, je crois que le monde est beaucoup moins hostile qu’on ne croit. En fait, il nous provoque, il nous provoque dans nos retranchements, à dire pourquoi nous défendons la vie, vous voyez.
Alors, effectivement, je crois que dans la théologie du corps, il y a un certain nombre de « pourquoi » et pas seulement de « comment ». Il faut commencer par les « pourquoi », parce que quand on est toujours dans l’injonction impérative, on devient complètement répulsif. Le « Parce que c’est comme ça et parce que c’est pas autrement », je suis désolé, c’est stupide. Je suis pour la vie parce que l’Église défend la vie, non, je suis pour la vie parce que Dieu est vie. Et que si nous sommes à l’image de Dieu, nous sommes à l’image d’un Dieu qui est vie. Et je suis capable d’expliquer pourquoi. Je suis capable de développer pourquoi. Je suis capable de vous l’expliquer, vous voyez.
Si bien que moi, je suis moins négatif par rapport à ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je crois que les auditoires les plus à l’écoute que j’ai eus depuis… ça fait 25 ans que j’enseigne la théologie du corps, ça fait 25 ans que je fais des conférences, j’en ai donné plus de 600 un peu partout, peut-être pas dans le monde, mais dans une bonne partie. Donc, j’ai rencontré des auditoires extrêmement différents. Je crois que, vous voyez, les personnes les plus réceptives, c’est celles qui, paradoxalement, étaient les moins familières de la foi chrétienne.
En fait, il est essentiel d’être capable de dire le pourquoi du comment, le pourquoi de la règle, et c’est exactement l’intention que Jean-Paul II avait avec sa théologie du corps. C’est que Humanæ Vitæ, c’est vrai, il n’y a pas un iota à changer à Humanæ Vitæ. Le problème c’est que sur les raisons pour lesquelles c’est vrai, ça fait trois petits paragraphes du numéro 8, onze lignes et demi, c’est trop court. Lui il a fait 800 pages pour expliquer cela. Mais quand vous lisez toute la théologie du corps, Humanæ Vitæ ça passe comme une lettre à la poste après, je vous le promets.
C’est pour cela que jamais je n’accepte de répondre d’abord à des questions avant d’avoir donné la lumière de la théologie du corps, jamais. Et vous apercevez que lorsque vous donnez la juste lumière, il y a un climat polémique qui se dissout, et les questions deviennent à ce moment-là des questions intelligentes et non pas des questions polémiques. Il faut d’abord donner la lumière, il faut d’abord donner le pourquoi, et c’est exactement ce que Jean-Paul II a fait dans sa théologie du corps. Avant de parler du respect de la vie. Alors ça, ça vient à la fin des catéchèses, à partir de la catéchèse 118 sur 125, il dit : « Ah oui, à l’égard du respect de la vie, il y a un certain nombre de choses qui sont en contradiction avec ce sens profond du corps tel que voulu par Dieu dans son plan d’amour de toute éternité. », et on comprend, vous voyez.
Et donc là, il y a un grand défi pour l’Église, ça passe par l’exigence des chrétiens de se former. Et si notre Église n’est pas assez missionnaire c’est parce que nos chrétiens sont paresseux, et ils ne se forment pas assez.
Consulter la deuxième partie de l’interview d’Yves Semen, interview personnelle : Yves Semen et l’annonce de l’Évangile du mariage